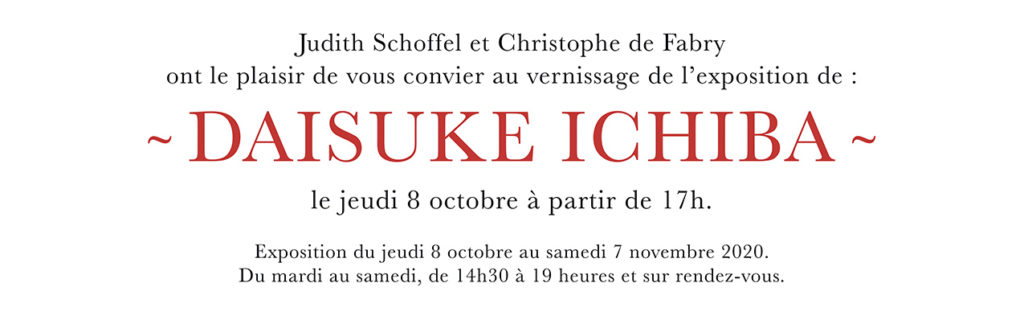Il développa son art à Tôkyô partir de la fin des années 1980 dans une pratique underground, Do It Yourself, centrée sur le dessin et l’autopublication d’ouvrages graphiques, à l’écart des institutions muséales et éditoriales. Il put ainsi créer en toute liberté, sans se plier aux carcans esthétiques et professionnels induits par la dépendance institutionnelle. À cet égard, son travail prolonge le courant heta-uma, initié au milieu des années 1970 par Teruhiko Yumura, qui prônait la spontanéité d’une « maladresse virtuose ». Dans ce sillage, Ichiba a développé la singularité d’un style qu’il nomme lui-même nandemo ari, « ouvert à toute possibilité ». « Mon style est un mélange de beaucoup de choses diverses : réalisme, abstraction, motifs répétitifs, bande dessinée, dessins enfantins, que j’équilibre grâce à mon sens esthétique personnel. »
Dans ses différentes pratiques – réalisation de livres et dessin, où il excelle, mais aussi peinture, collage, photographie, vidéo, musique, performance -, il cherche à équilibrer des éléments disparates pour parvenir à une harmonie qui n’abolit pas en son sein les différences et les tensions, ce qui décuple la puissance suggestive de ses images. « Pour moi, dit-il, les choses forment des paires ou des ensembles, et je ne suis pas satisfait tant que je n’ai pas inséré toutes leurs composantes dans le même plan. Je n’aime ni la beauté, ni la laideur à l’état pur. Les deux doivent se mélanger. »
Pour y parvenir, il importe de laisser advenir en soi le « chaos », terme par lequel il désigne « l’idée d’un espace où tout se mêle et fusionne », sa principale source d’inspiration : « Mon art, c’est le chaos. Je crée une harmonie de divers états humains, comme la douceur, la violence, la beauté, la laideur, le mignon et le bouffon, etc. »
C’est sur fond de chaos que surgit le monde inquiétant et fascinant d’Ichiba, irréductible à l’ero-guro, genre artistique en vogue au Japon combinant de manière stéréotypée des éléments érotiques, macabres et grotesques. Même s’il joue parfois avec les codes de ce genre, c’est en réalité pour aller ailleurs, et créer son propre « chaosmos » – selon le mot de Joyce dans Finnegans Wake -, peuplé de jeunes filles élancées, aux regards étranges, plus ou moins dénudées et souvent suppliciées ou marquées par la maladie ; de militaires aussi ridicules que tyranniques ; de monstres polymorphes, revisitant avec fantaisie l’univers des yôkai ; le tout dans des architectures vacillantes et des milieux naturels déchaînés où prolifèrent d’improbables floraisons.
Cette quête de l’harmonie, intense et à jamais inachevée, à partir de disparités indépassables (composition/décomposition, vie/mort, beauté/laideur, santé/maladie, paix/violence, rêve/cauchemar, tradition/modernité, dessin/couleur, etc.), est celle d’un maître en l’art subtil d’équilibrer les dissonances.
Xavier-Gilles Néret